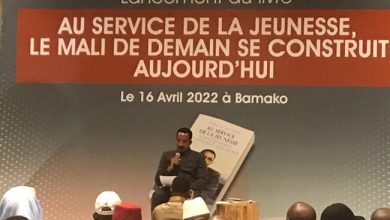GOOGAN Tan : Mali-Mauritanie : le voisinage n’est pas un slogan, c’est une responsabilité !
Meguetan Infos

En tournée dans le sud-est de son pays, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a fait halte, ce lundi 10 novembre, à Bassikounou, ville-frontière posée comme une vigie hésitante sur les confins maliano-mauritaniens.
Une escale symbolique survenue dans un climat alourdi : fermeture de la frontière par le Mali, crispations agropastorales, tensions politiques et surtout mise à nu d’une réalité que bien des officiels mauritaniens s’efforcent de maquiller sous les voiles de la diplomatie.
Devant les notables, le chef de l’État mauritanien a opté pour l’apaisement : « Le Mali est actuellement en guerre, il faut le reconnaître. On ne peut attendre d’un voisin en guerre les mêmes traitements qu’en temps de paix. » Un propos volontairement conciliant, presque paternel, destiné à calmer les inquiétudes d’éleveurs mauritaniens privés des pâturages maliens où, depuis des générations, s’alimente plus de 70 % du cheptel mauritanien : près de trente millions de têtes qui broutent neuf mois sur douze les herbes de l’immense tapis végétal malien. Ce cycle pluriséculaire vient d’être brutalement interrompu par une décision souveraine du Mali.
Mais derrière cette crise apparente, derrière les plaintes des éleveurs et la douceur calculée du discours de Ghazouani, se profile une vérité autrement plus dérangeante : la Mauritanie n’est pas seulement un voisin inquiétant ; elle est devenue, pour de nombreux Maliens, un refuge officieux de forces hostiles au Mali, une arrière-cour logistique où groupes djihadistes trouvent soins, repli et facilités.
Cette évidence, longtemps étouffée sous la raison d’État, a été confirmée par plusieurs partenaires du Mali, dont la Russie, qui ont publiquement évoqué des cellules terroristes opérant depuis le territoire mauritanien.
Et puis, il y a cette singularité mauritanienne, qui intrigue autant qu’elle dérange : dans toute la bande sahélo-saharienne, la Mauritanie est le seul pays que les groupes terroristes n’ont pas visé depuis plus de dix ans. Un îlot de tranquillité dans une mer de feu. Une exception qui crève les yeux. Comment comprendre que l’unique pays épargné soit précisément celui où les assaillants trouvent refuge, soins et répit après avoir frappé le Mali sur une frontière longue de près de deux mille kilomètres ? Cette ambiguïté s’est accentuée lorsque Nouakchott a procédé, il y a quelques mois, à un refoulement massif et inhumain de migrants maliens : camps improvisés, trajets forcés, familles disloquées.
Un épisode sombre, d’autant plus incompris que les deux peuples partagent un voisinage ancien, des brassages constants et une profonde parenté culturelle et spirituelle. En renvoyant des milliers de Maliens sans même un préavis, le président El Ghazouani imaginait sans doute que le Mali, absorbé dans une guerre existentielle, n’aurait ni le souffle politique ni l’assise stratégique pour répondre. Il s’est trompé !
La fermeture de la frontière a été un rappel cinglant des interdépendances. Car, du jour au lendemain, le cheptel mauritanien s’est retrouvé sevré, et le déplacement présidentiel au sud du pays sonne comme une prise de conscience tardive : ce n’est plus une question diplomatique, mais une urgence nationale.
À Bassikounou, El Ghazouani déclare : « Le Mali reste un peuple frère (…) Ce n’est pas parce que nos frères sont en guerre qu’il faut oublier ce qui nous lie. »
Une formule fraternelle, sans doute sincère, mais qui résonne comme un pansement tardif sur une plaie à vif.
Car depuis plus de douze ans, tandis que le Mali mène un combat titanesque contre le terrorisme, la Mauritanie s’est tenue en retrait, parfois complaisante, souvent silencieuse. Pas un message de soutien. Pas une compassion officielle. Pas un geste de solidarité. Rien ! Comme si la tragédie malienne n’était qu’une affaire isolée, alors que la géographie du Sahel impose un destin partagé.
Dans cette guerre asymétrique, le Mali joue pourtant un rôle de digue : Il est ce « couvercle sur la marmite en ébullition », pour reprendre la sagesse bambara, retenant au prix du sang l’avancée djihadiste vers l’ouest.
Retirez ce couvercle, et c’est toute la région qui vacille.
Je le redis la fermeture de la frontière est un signal premier signal, notre pays dispose d’autres leviers : Le Mali n’acceptera plus que prospère, dans l’indifférence, une duplicité qui menace sa souveraineté et la vie de ses citoyens. Car malgré le ton adouci du président mauritanien, les zones d’ombre persistent :
– silence prolongé face aux massacres perpétrés au Mali ;
– absence de condamnation claire du terrorisme ;
– usage de son territoire comme zone tampon ;
– renvois massifs et humiliants de Maliens.
Une simple déclaration d’apaisement ne suffit plus à effacer des années d’ambiguïtés.
La tension actuelle n’a donc rien d’un accident. Elle procède d’une réalité plus profonde : la Mauritanie a longtemps voulu bénéficier du voisinage malien (pâturages, échanges, influence) tout en se tenant à l’écart de ses drames et, parfois, en servant de repli à ceux qui les provoquent. Aujourd’hui, la vérité s’impose. La tournée d’El Ghazouani n’est pas un exercice de proximité : c’est la manifestation publique d’une dépendance agropastorale vitale et d’une crise que l’on ne peut plus dissimuler.
La frontière fermée n’est pas une simple ligne sur la carte : elle est devenue le miroir d’une décennie de duplicité.
Dans ce contexte, le Mali, malgré ses blessures et ses sacrifices, demeure le rempart qui protège toute la sous-région d’une marée qui ne cesse de monter. Ignorer ce rôle, le minimiser ou l’instrumentaliser revient à courir des risques dont les conséquences dépasseront largement les deux rives de la frontière.
« Les crises passent », a dit le président mauritanien. Certes ! Mais encore faut-il avoir le courage de regarder en face ce qui les provoque. Oui ! Entre deux pays liés par l’histoire, le voisinage n’est pas un slogan : c’est une responsabilité.
Une responsabilité que le Mali assume au prix fort, et disons le net et fort aucun voisin, désormais, ne peut plus se permettre de l’éluder.
Dicko Seidina Oumar journaliste – Historien – Écrivain
Source : Aujourd’hui