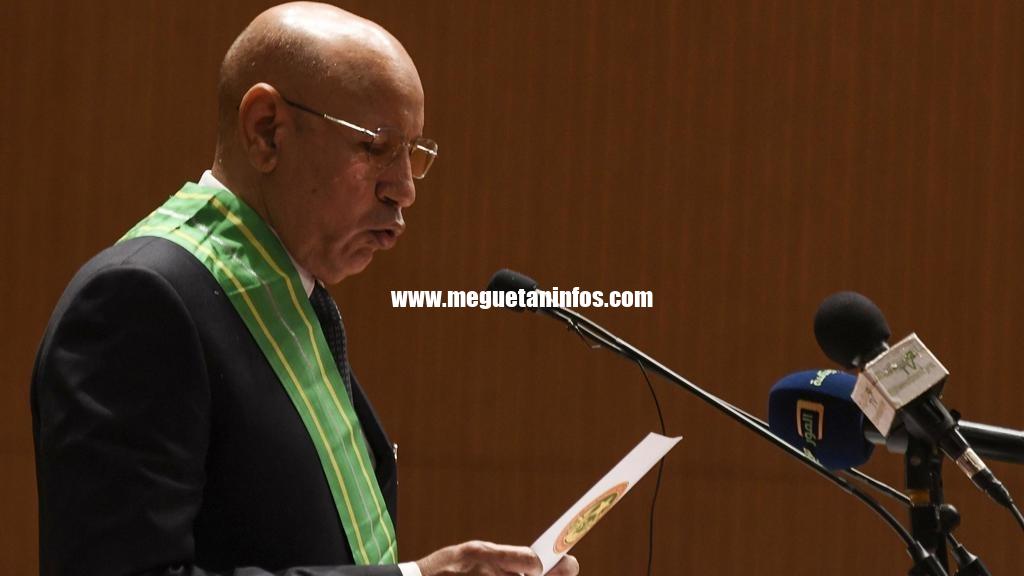113 Novembre 2015: De Paris à Bamako, le même sang versé au nom de la guerre contre le terrorisme.
Meguetan Infos

Le 13 novembre 2015, la France vivait l’une des nuits les plus sombres de son histoire moderne. Des attaques coordonnées frappaient Paris et Saint-Denis, faisant 130 morts et plus de 350 blessés. Dix ans après, la douleur demeure vive dans la mémoire collective. Mais dans le même temps, au Sahel, cette tragédie allait ouvrir un autre chapitre, plus lointain mais tout aussi dramatique : celui des horreurs de l’opération Barkhane au Mali, menée au nom de la même lutte contre le terrorisme.
Quand la France pleurait, l’Afrique tremblait
Les attentats du 13 novembre 2015 ont profondément ébranlé la France. Ils ont aussi déclenché une riposte militaire et sécuritaire sans précédent : l’intensification de la guerre contre le terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique, notamment dans le Sahel.
L’armée française, déjà présente dans la région à travers l’opération Serval (2013), allait élargir son champ d’action avec l’opération Barkhane, lancée en août 2014 et renforcée après 2015.
Son objectif affiché : éradiquer les groupes djihadistes qui menaçaient la stabilité du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad. Mais cette guerre « sans fin » a vite montré un autre visage.
Barkhane : de la protection à la désillusion
Sur le terrain malien, les populations ont d’abord accueilli les soldats français comme des alliés. Puis, au fil des années, les bavures, les frustrations et la perception d’une occupation étrangère ont terni l’image de la mission.
Des villages entiers, notamment à Bounti ou Gossi, ont été marqués par des frappes controversées ayant fait des victimes civiles.
La guerre contre le terrorisme est ainsi devenue, pour beaucoup, une guerre contre les peuples.
Les Maliens, comme les Français, ont payé le prix fort, mais dans un silence international souvent assourdissant.
Deux blessures, une même logique
À Paris comme à Bounti, c’est la même peur, la même incompréhension qui habite les familles endeuillées : celle de perdre des proches au nom d’une cause qui les dépasse.
Les attentats du 13 novembre ont révélé la vulnérabilité des sociétés occidentales face à la radicalisation, tandis que les erreurs de Barkhane ont nourri la colère et la défiance des populations sahéliennes envers leurs dirigeants et leurs partenaires étrangers.
Au fond, la guerre contre le terrorisme, censée apporter la sécurité, a engendré davantage de divisions, de violences et d’humiliations.
Le prix humain et politique
Aujourd’hui, la France commémore ses victimes. Le Mali, lui, tente de se relever d’une décennie d’instabilité, de coups d’État, et d’une crise sécuritaire profonde.
L’échec de Barkhane a contribué à la rupture diplomatique entre Bamako et Paris, ouvrant la voie à de nouvelles alliances et à un repositionnement stratégique dans la région.
Mais au-delà de la géopolitique, c’est une question morale qui persiste : jusqu’où la lutte contre le terrorisme peut-elle aller sans détruire les valeurs qu’elle prétend défendre ?
Une leçon commune : la paix n’a pas de frontière
Les attentats du 13 novembre et les horreurs de Barkhane rappellent que le terrorisme ne se combat pas uniquement par les armes, mais aussi par la justice, la dignité et le dialogue.
Les peuples de Paris et de Bamako, bien que séparés par des milliers de kilomètres, portent la même cicatrice : celle d’une guerre mondiale sans nom, où les innocents meurent toujours les premiers.
La Rédaction